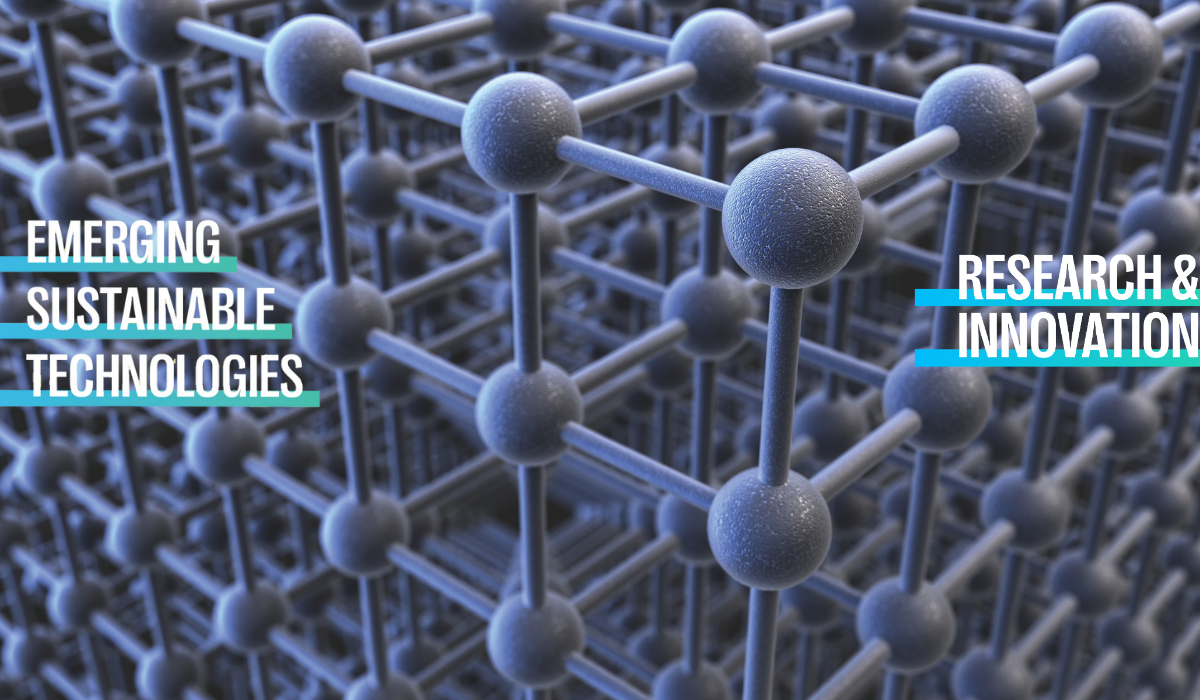

L'effet élastocalorique est une réponse thermique réversible offrant des alternatives prometteuses à la réfrigération traditionnelle par compression de vapeur, comme le démontrent des études en laboratoire et des validations de principe.
Le chauffage et la climatisation représentent près de 50 % de la consommation énergétique finale dans les pays développés, devant l’électricité (20 %) et les transports (30 %). Ces usages sont responsables de plus de 40 % des émissions mondiales de CO₂ liées à l’énergie. Avec l’essor des économies émergentes et l’aggravation du réchauffement climatique, la demande en climatisation pourrait croître de 45 % d’ici 2050 par rapport à 2016.
La technologie de refroidissement la plus répandue aujourd'hui repose sur le cycle de compression-détente de gaz, la climatisation (AC) étant sa forme la plus avancée. Les systèmes de climatisation vont des petites unités pour une seule pièce aux grandes installations pour des bâtiments et des quartiers entiers.
La plupart des systèmes de climatisation fonctionnent à l'électricité, mais les plus grands peuvent également utiliser le gaz naturel, la chaleur résiduelle ou l'énergie solaire. Actuellement, les climatiseurs représentent près de 20 % de la consommation mondiale d'électricité des bâtiments, un chiffre qui devrait augmenter avec la croissance économique et démographique des régions plus chaudes.
Ces technologies reposent sur le principe selon lequel les liquides absorbent la chaleur lors de leur évaporation et la restituent lors de leur condensation (cycle de Carnot classique). Des composés chimiques spécifiques, appelés réfrigérants, qui changent facilement d'état à basse température, sont utilisés dans un circuit fermé.
Les technologies traditionnelles de chauffage et de climatisation, bien qu'efficaces, présentent des inconvénients majeurs : une consommation énergétique élevée et l'utilisation de réfrigérants à fort potentiel de réchauffement climatique. Il est donc impératif de développer des alternatives plus efficaces, plus respectueuses de l'environnement et plus rentables.
Les matériaux solides avancés (magnétocaloriques, électrocaloriques, barocaloriques, élastocaloriques) offrent une alternative prometteuse. Ces matériaux exploitent des stimuli externes (champ magnétique, pression, contrainte mécanique) pour produire des variations de température, sans changement d’état liquide-gaz.
Les matériaux élastocaloriques présentent des variations de température marquées lorsqu’une contrainte mécanique est appliquée puis supprimée, un processus connu sous le nom d’effet élastocalorique. Cette réponse thermique réversible offre des alternatives prometteuses à la réfrigération traditionnelle par compression de vapeur, comme le démontrent des études en laboratoire et des validations de principe.
Ce cycle, entièrement réversible, permet de remplacer les composants clés des systèmes traditionnels (compresseurs, réfrigérants) par des actionneurs mécaniques et des matériaux solides.
Le coefficient de performance du matériau (COPmat) est essentiel pour évaluer le potentiel de refroidissement d'un matériau élastocalorique.
Certains matériaux élastocaloriques peuvent atteindre des COP supérieurs à 70 %, surpassant ainsi les pompes à chaleur conventionnelles à fluide frigorigène (COP typique compris entre 40 % et 60 %). Cependant, le COP global du système est considérablement réduit en raison des pertes au niveau de l'échangeur de chaleur, de l'actionneur, de la régénération et de la consommation d'énergie auxiliaire. L'efficacité est affectée par les pertes mécaniques et thermiques, la récupération limitée de chaleur/travail et le recours à des auxiliaires énergivores.
Bien que les progrès réalisés dans les matériaux et les actionneurs aient amélioré les prototypes, il reste difficile de savoir quand les systèmes élastocaloriques surpasseront les pompes à chaleur conventionnelles en termes d’efficacité globale.
Avantages
Défis
Les systèmes élastocaloriques pourraient répondre à des besoins critiques, notamment dans les régions les plus exposées au changement climatique. Pour favoriser leur adoption, il est essentiel de :
Pour aller plus loin :
Consultez le rapport 2025 d’ENGIE sur les technologies durables émergentes pour plus d’exemples, de cas d’usage et d’analyses.
> Téléchargez le rapport 2025 sur les technologies durables émergentes <